This post is about a recent French case which shows that, while French copyright law protects original handbags, explaining what exactly makes a bag original has to be carefully worded, by the parties of course, but for the courts as well. The Cour de cassation, France highest civil court, “broke” (‘casser’) a holding of the Paris Court of appeals which, after having listed the various elements which made a bag original, found no copyright infringement of this bag evenwhile referring to other original elements of the bag.
Longchamp is a French bag and accessories company. Its most famous model is the Pliage bag, a nylon bag which can be folded to fit in a smaller bag (pliage means ‘folding’ in French). Its success led to the creation of a whole range of Pliage bags, which are now available in nylon and leather, may or may not be foldable, and can even be personalized.
Longchamp discovered in 2010 that bags similar to its Pliage bag were sold online. The company and the original designer of the bag sued the seller and the manufacturer of the bags sold online for copyright infringement. The court of first instance, the Tribunal de Grande Instance de Paris (TGI) rejected their claims. For the TGI, the Pliage bag was indeed protectable, but the defendants had not infringed on any of the plaintiff’s rights. Plaintiffs appealed, but the Paris Court of Appeals confirmed the judgment on September 13, 2013. Longchamp and the Pliage bag designer then took their case to the Cour de cassation.
The Pliage bag is indeed famous. Plaintiffs even claimed on appeal that it is the most copied bag in the world. Appellees did not dispute the originality of the Pliage bag, but argued instead that, because the bag was an original combination of several mundane elements, only this original combination could be protected by copyright, not the separate elements. They further argue that the Pliage bag was a combination of elements ordinarily used by every bag designer, and specific, original characteristics, “namely the specific form of the flap highlighted by the thick stitched sewing, the gold button [closing the snap], highly visible seams on all sides of the leather elements, the combination of brown leather stitched with other materials, and specific proportions.”
The Court of Appeals agreed that the Pliage bag is original, as it combines these elements:
– small flap with snap, located between the two handles and a cap portion of the zipper;
– slightly rounded shape of this little flap, highlighted by a thick stitched sea
- – sewing stitches on the front of the bag, in the extension of the flap and evoking the outline of the inner bag;
- – affixing of the flap on the back of the bag by a double stitched seam;
- – two handles finishing by rounded edges affixed on each side of the bag opening by affixed tabs;
- -two small rounded tabs on each end of the zipper which highlight the top corners of the bag, curving upward;
- – the trapezoidal shape of the body, seen from the front;
- – the rectangular bottom and
- – the triangular profile.
The Court of Appeals then compared the Pliage bag with the allegedly counterfeiting bag and did not find it infringes on Pliage. To come to this conclusion, the Court of Appeals noted that the Appellee’s bag had a wider flap, did not feature stitched seams and did not have a small gold button to snap close the front flap. Also, both flaps had different shapes, and the stitches of Appellee’s bag used the same color than the bag’s overall material, whereas the bag’ s stitches contract in color with the body of the bag. The handles of Appellee’s bag did not feature stitches, and the ending part of the handles had a different shape. Also, both bags had different shape, rectangular for Appellee’s bag and trapezoidal for the Pliage bag.
The Court of Appeals noted that Appellee’s bag would have been counterfeiting the Pliage bag if it had used “the distinguishing characteristics of the combination of Longchamp bag model: the specific form of the flap emphasized by the thick stitched sewing, gold button, highly visible seams on all leather parts, the alliance of brown leather stitched with other materials and colors, the specific proportions, which are the dominant elements of the combination giving the model its originality.”
The Court of Appeals found that Appellee’s bag had “its own physiognomy, a particular aesthetic bias which alter the overall visual impression of this model as compared to the Longchamp bag, which precludes any risk of confusion, especially since the discriminating consumer of the famous Longchamp bag would immediately perceive these differences.” Somehow, the right holders of a famous bag would have to meet an even higher burden of copyright infringement proof because their work is famous.
But the Cour de cassation found that, by this ruling, the Court of Appeals had violated article L. 122-4 of the French IP Code, which makes it illegal to reproduce fully or partially a protected work without authorization of the right holder. For the high court, “the existence of a golden button, the alliance of brown leather stitched with other materials and colors, and the « specific proportions » [of the bag] were not the elements that the Court had chosen to assess the originality of the bag, and also, the existence of a likelihood of confusion is irrelevant to the characterization of the infringement of copyright.”
This last phrase is a welcome addition to the French fashion copyright attorney’s toolbox, especially when defending the rights of famous bags, such as the Pliage, or, say, the Birkin, which would otherwise have to convince courts that the sophisticated clientele would never take a $75 plastic Birkin for the real McCoy. French Copyright does not serve as an indication of the source, but, rather, protects the patrimonial and moral rights of the author of the work.
Image is courtesy of Flickr user Maurina Rara under a CC BY 2.0 license.
This article was first published on The 1709 Blog.




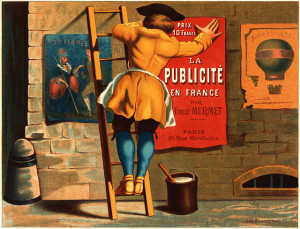





 New York Attorney. Educated in France and in the U.S. I miss baseball when I am in France and runny cheese when I am in the U.S.
New York Attorney. Educated in France and in the U.S. I miss baseball when I am in France and runny cheese when I am in the U.S. I am a lawyer, and this blog is (mostly) about law, but nothing I write on the blog is legal advice. I hope you’ll find what I write to be of interest, but do not rely on it. For more information, please visit the
I am a lawyer, and this blog is (mostly) about law, but nothing I write on the blog is legal advice. I hope you’ll find what I write to be of interest, but do not rely on it. For more information, please visit the 



