A. Malka est photographe de mode. Trois de ses photographies, représentant le visage maquillé d’une jeune femme, avaient été publiées en décembre 2005 dans un magazine italien. L’artiste Peter K. les reproduisit sans autorisation dans plusieurs de ses œuvres, telle que Blue Face/Red Machine/High Voltage. Les photographies avaient été colorisées en bleu et inclues dans des compositions d’éléments industriels et urbains, tels des panneaux de signalisation et des manettes, selon un thème exploré par l’artiste depuis plus de quarante ans.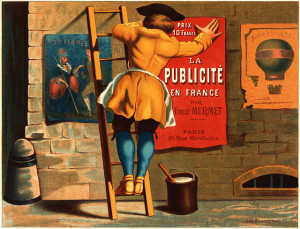
A. Malka assigna Peter K. en contrefaçon de droit d’auteur, mais le Tribunal de Grande Instance de Paris déclara sa demande irrecevable parce que les photographies ne portaient pas suffisamment l’empreinte de sa personnalité pour pouvoir être protégées par le droit d’auteur et qu’en outre Peter. K. pouvait invoquer l’exception de parodie.
A. Malka fit appel, et la Cour d’appel de Paris (18 septembre 2013, n° 12/02480) condamna Peter K. à 50.000 euros de dommages et intérêts pour atteinte au droit patrimonial et au droit moral d’A. Malka sur ses œuvres. Celui-ci se pourvut en cassation. Le 15 mai dernier, la première Chambre civile de la Cour de cassation cassa l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Protection des photographies de mode par le droit d’auteur
La Cour d’appel de Paris avait jugé que les photographies d’A. Malka étaient bien protégées par le droit d’auteur. Elles traduisaient « un réel parti pris esthétique empreint de la personnalité de leur auteur » car le photographe avait opéré des choix tels que la mise en évidence de manière excessive de touches de couleur vives contrastant avec un visage très pâle et avait choisi des angles de vue originaux. Peter K. avait argumenté en vain en appel que ces photographies n’étaient pas originales et qu’elles n’étaient que l’expression d’un genre photographique, le « genre glamour ». Il avait repris cet argument en cassation sans plus de succès. La Cour de cassation reconnut bien que les photographies de mode étaient des œuvres protégées par le droit d’auteur.
Liberté d’expression et droit d’auteur
La Cour de cassation cassa néanmoins l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, au visa de l’article 10 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CESDH) qui protège le droit à la liberté d’expression. Selon la Cour de cassation, il doit exister un « juste équilibre » entre « la liberté d’expression artistique » de Peter K. et les droits patrimoniaux et moral d’A. Malka.
Pour la Cour d’appel de Paris, si Peter K. était bien
« un artiste connu pour transformer des images comme symboles du goût d’une société pour le confronter à d’autres images qu’elle ne voudrait pas voir, les utilisations litigieuses ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une démarche artistique relevant de la parodie alors que Peter K. en fait conservé les représentations du visage du mannequin dans une pose inchangée, sans la priver de l’impact attirant voulu par son auteur, les confrontant seulement à d’autres représentations décalées, généralement d’objets, permettant de s’interroger sur la pertinence de l’attraction induite par l’œuvre première. »
La Cour d’appel avait jugé que puisque les œuvres de Peter K. n’étaient pas la parodie des photographies d’A. Malka, leur utilisation sans autorisation n’était par conséquent pas autorisée par l’exception de parodie, ni, d’ailleurs, par celle de courte citation prévu par l’article L 122-5 2° a) du Code de la propriété intellectuelle, car« les photographies utilisées occupent une place non négligeable dans les œuvres litigieuses ». Pour la Cour d’appel, le fait que Peter K. n’ait pas repris tous les éléments de la photographie originale, par exemple, en ne reproduisant pas la chevelure de la jeune femme photographiée par A. Malka, ne faisait pas de son utilisation des photographies une citation, car il demeurait « la représentation très caractéristique du visage tel que photographié ».
Mais pour la Cour de cassation, c’est à tort que la Cour d’appel avait retenu « que les droits sur des œuvres arguées de contrefaçon ne sauraient, faute d’intérêt supérieur, l’emporter sur ceux des œuvres dont celles-ci sont dérivées, sauf à méconnaître le droit à la protection des droits d’autrui en matière de création artistique » et elle avait ainsi privé de base légale sa décision au regard de l’article 10 § 2.
Cet arrêt de la première Chambre civile est particulièrement intéressant parce qu’il est rendu au visa de l’article 10 § 2 de la CESDH et non celui de l’article L 122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle qui autorise l’utilisation d’une œuvre protégée à des fins de parodie, pastiche ou caricature, « compte tenu des lois du genre ». Le champ d’application de l’article 10 § 2 est bien plus étendu que celui de l’article L 122-5 4°, puisqu’il ne se limite pas à l’autorisation de trois genres, parodie, caricature et pastiche, bridés de surcroit par leurs « lois du genre », un concept des plus vagues par ailleurs. En effet, l’article 10 § 1 proclame le droit de toute personne à la liberté d’expression, dont l’exercice peut néanmoins être soumis, selon l’article 10 § 2, « à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi [si elles ] constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à (…) la protection (…) des droits d’autrui ». On le voit, il s’agit pour les juges de trouver un juste équilibre entre droit d’expression et droits d’autrui, tel un droit de propriété intellectuelle.
Cet arrêt signale peut-être l’ouverture de la Cour de cassation à un fair use à la française par le biais de la CESDH. Ce serait heureux, car nombreux sont les artistes qui utilisent des œuvres protégées afin de créer des œuvres nouvelles, depuis Marcel Duchamp qui inventa l’art de l’appropriation. C’est bien le cas de Peter K., qui fait partie du mouvement de la Figuration Narrative. Il avait expliqué devant la Cour d’appel avoir choisi les photographies d’A. Malka car elles étaient, selon lui, un symbole de la publicité et de la surconsommation. Son intention était de modifier ces images publicitaires afin de les détourner de leur fonction première de photographie de mode et de provoquer une réflexion.
L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles. C’est désormais à cette cour de à trouver le « juste équilibre » entre le droit d’auteur d’A. Malka et le droit de Peter K. à s’exprimer par ses œuvres. Si le droit de Peter K. à s’exprimer est jugé supérieur à celui, patrimonial et moral d’A. Malka, la Cour d’appel jugera qu’il n’y a pas contrefaçon. Si, au contraire, le droit moral et les droits patrimoniaux seront jugés supérieurs au droit à la liberté d’expression, il y aura contrefaçon. La Cour de cassation n’a donné aucun vademecum à la Cour d’appel, et c’est pourquoi la lecture des justifications de la décision de la Cour d’appel de Versailles ne manquera pas d’être d’un grand intérêt.
Image courtesy of Flickr user trialsanderrors under a CC BY 2.0 license.







 New York Attorney. Educated in France and in the U.S. I miss baseball when I am in France and runny cheese when I am in the U.S.
New York Attorney. Educated in France and in the U.S. I miss baseball when I am in France and runny cheese when I am in the U.S. I am a lawyer, and this blog is (mostly) about law, but nothing I write on the blog is legal advice. I hope you’ll find what I write to be of interest, but do not rely on it. For more information, please visit the
I am a lawyer, and this blog is (mostly) about law, but nothing I write on the blog is legal advice. I hope you’ll find what I write to be of interest, but do not rely on it. For more information, please visit the 



